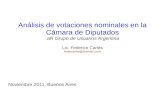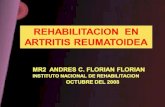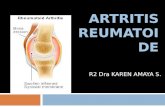013706 Ar
-
Upload
carlos-mejia-reyes -
Category
Documents
-
view
5 -
download
0
description
Transcript of 013706 Ar
-
rudit es un consorcio interuniversitario conformado por la Universit de Montral, la Universit Laval y la Universit du Qubec Montral. Su
misin es la promocin y la valorizacin de la investigacin. rudit ofrece servicios de edicin de documentos cientficos desde 1998.
Comunquese por favor con el equipo de rudit en : [email protected]
Artculo
Hans JoasSociologie et socits, vol. 38, n 1, 2006, p. 15-29.
Para citar este artculo, utilizar las informationes siguientes :
URI: http://id.erudit.org/iderudit/013706ar
DOI: 10.7202/013706ar
Nota: Las reglas de escritura de las referencias bibliogrficas pueden variar segn los diferentes dominios del conocimiento.
Este documento est protegido por la ley de derechos de autor. La utilizacin de los servicios de rudit (comprendida la reproduccin) se rige
por su poltica de utilizacin que se puede consultar en el URI http://www.erudit.org/apropos/utilisation.html?lang=es
Documento descargado el 3 marzo 2014 06:42
Foi et morale lge de la contingence
-
Dans son livre A Far Glory1 le clbre sociologue des religions et penseur reli-
gieux protestant Peter Berger raconte une vieille blague amricaine.
Deux amis se rencontrent dans la rue quelque part dans le sud de la Californie. Lun desdeux a lair trs malheureux et lautre lui demande pourquoi il a lair si triste. Jai trouvun boulot. Un boulot horrible . Qua-t-il donc de si horrible ? coute bien ce que jai faire. Je travaille dans une orangeraie. Jy passe toute la journe assis au pied dun arbreet les autres gars mapportent des oranges. Je trie les grandes dans un premier panier, lespetites dans un second et les moyennes dans un troisime panier. Et je fais a toute lajourne. Son ami dit : Je ne comprends pas. a sonne pourtant bien. En quoi te drangedonc cette activit plaisante ? Les nombreuses dcisions que jai prendre ! lui rpond-il (Berger, p. 175f, traduction).
Avec cette blague, nous sommes au cur de la thmatique de la religion, de la
contingence et du pluralisme. Personne ne conteste que laugmentation des possibili-
ts daction, telle quelle se produit dans le cadre des processus de modernisation,
entrane une croissance du nombre de dcisions prendre et que cette croissance puisse
hans joasMax-Weber-KollegUniversitt ErfurtAm Hgel 1D-99084 ErfurtCourriel : [email protected]
Traduction : David Ouellette
15
Foi et morale lge de la contingence
1. Peter L. Berger, A Far Glory. The Quest for Faith in an Age of Credulity, New York, 1992.
Socsoc_v38n01_v2.qxd 11/10/06 15:35 Page 15
-
tre vcue par beaucoup de gens non seulement comme la ralisation de leur libert,
mais aussi comme une contrainte la libert. La notion de contingence est passe dans
lusage pour dcrire ces rapports. Personne ne conteste non plus que la possibilit de
dcider lorsquelle renvoie lhomme lui-mme, cest--dire lorsquune marge de
manuvre, dans certaines limites du moins, se prsente lautodtermination
entrane un pluralisme des cultures, des sous-cultures et des individus, ou fortifie un
pluralisme dj existant. Cependant, les opinions divergent largement sur la manire
dont sont prcisment lis entre eux la contingence et le pluralisme et comment, en par-
ticulier dans le champ de la religion, ils se comportent lun envers lautre et quelles
consquences ils ont sur lattachement aux valeurs, sur la foi, et sur la vitalit et la
transmission de cette dernire.
Parce que les interprtations de Peter Berger, auquel je dois la blague cite en intro-
duction, sont particulirement influentes dans les cercles universitaires, mais aussi
ecclsiastiques, et quen mme temps, de nombreux rsultats empiriques importants ne
les confirment pas et que leurs hypothses philosophiques darrire-plan sont trs pro-
fondment problmatiques, je voudrais les utiliser dans ce qui suit comme toile de
fond, de manire mieux contraster mes propres pistes dinterprtation.
Peter Berger ne met pas vraiment laccent sur la contingence, mais plutt sur le plu-
ralisme en tant que tel. Sa dfinition du pluralisme, proche de lusage quotidien du
mot, est la coexistence, le ctoiement largement paisible de divers groupes dans une
et mme socit (Berger, p. 37, traduction). Ainsi, le pluralisme religieux nest rien
dautre quune des nombreuses variantes de ce phnomne ; la coexistence est
dtermine encore plus prcisment, en disant quelle implique aujourdhui non seu-
lement labsence de tuerie mutuelle, mais encore quelle se caractrise par un certain
degr dinteraction sociale. Cest justement sur cette caractristique que Berger insiste
particulirement, car pour lui, une coexistence sans interaction, vivre cte cte en
prsence de barrires sociales insurmontables, ne correspond videmment pas enti-
rement au concept du pluralisme.
Berger est cependant nettement conscient que le pluralisme moderne ne repr-
sente pas une vritable nouveaut dans lhistoire du monde, bien quil tende le consi-
drer comme lexception plutt que la rgle. Le pluralisme daujourdhui est, selon lui,
assurment apparent celui de lAntiquit (Berger, p. 127), et en particulier aux condi-
tions de vie dans les grandes cits-tats de lpoque hellnistique et romaine tardive.
Il ne voit de spcificit propre au pluralisme moderne que dans son ampleur : les villes
toujours plus grandes et plus htrognes de notre poque, dans lesquelles des gens de
toutes les cultures du monde vivent ensemble dans un espace des plus restreints et se
rencontrent frquemment. La culture de ces villes et le pluralisme en gnral affectent
de plus en plus aussi les espaces ruraux, pour autant que ceux-ci ne soient pas dj en
fait urbaniss.
Pour Berger, suivre la trace la dynamique sociopsychologique du pluralisme est
beaucoup plus important que dterminer prcisment et mme quantitativement dans
quelle mesure cette hypothse sapplique des villes et des rgions concrtes. Il for-
16 sociologie et socits vol. xxxviii.1
Socsoc_v38n01_v2.qxd 11/10/06 15:35 Page 16
-
mule ici des hypothses psychologiques trs fortes. De la coexistence paisible des cul-
tures et des religions sans barrires rsulte, pour Berger, ce quil appelle la contami-
nation cognitive, un mlange de styles de vie, de valeurs et de croyances religieuses
diffrents. Ainsi, son hypothse psychologique darrire-plan veut que les hommes,
dans leur rencontre avec dautres valeurs et reprsentations du monde, concluent invi-
tablement que tout nest peut-tre pas aussi vident quils ne le supposaient auparavant,
que les autres ont possiblement aussi telle ou telle autre bonne ide.
La fissure dans notre vision du monde peut tre minuscule au dpart, mais elle tend
grossir et se transformer en vritable brche. Au terme de ce dveloppement appa-
rat le relativisme ltat pur, pour lequel toutes les convictions et les valeurs sont ga-
lement bonnes, ou, du moins, toutes galement sans fondement. Berger voit un
symptme de ce relativisme rampant dans lapplication du concept conomique de la
prfrence la religion, laquelle est courante dans une partie de la sociologie des
religions et, du moins aussi, dans le quotidien amricain. Lorigine linguistique de cette
formule, estime Berger juste titre, rside dans la sphre du comportement de
consommation et non pas dans celle du martyre (Berger, p. 83, traduction). La foi
comme telle et toute foi en particulier prennent ds lors lallure dune simple option,
changeante et purement subjective. Cependant, Berger ne rejette pas cette formule, car
elle lui parat frapper dans le mil (Berger, p. 67f, traduction) ltat de fait :
Lappartenance religieuse de lindividu, aujourdhui, nest [plus] une ralit irrvocable etfixe, ralit quil ne peut pas plus changer que son hritage gntique ; elle devient pluttlobjet de son choix, un produit de ce processus par lequel il construit et constitue sonmonde et non soi (traduction).
Vhicul par de tels mcanismes psychologiques, le pluralisme contribuerait la
scularisation. Peter Berger ne considre pas le pluralisme comme lunique cause, mais
plutt comme un important facteur contribuant au dclenchement de la scularisation.
Le pluralisme renforcerait les autres facteurs (comme la technologie et la science, les-
quelles, croit galement Berger, ont un effet scularisateur) avec pour rsultat la mise
en uvre dune volution en quelque sorte hlicodale : Cest--dire, on peut avancer
que la modernit provoque une fertilisation rciproque entre pluralisme et scularit
(Berger, p. 40, traduction).
Il manque encore un lment cette reconstruction du noyau du diagnostic de la
religion de Berger qui servira de toile de fond mes propres interprtations ultrieures.
Le relativisme subjectif nest notamment pas pour lui lunique rsultat possible de la
contamination cognitive dont il parle. Il diffrencie, du moins en vue des commu-
nauts chrtiennes, quatre formes de ractions possibles : ngociation, capitulation,
retranchement dfensif ou offensif. Dans le premier cas, des concessions cognitives
sont faites selon le mode de la thologie librale afin de sauver le noyau de la foi ; dans
le deuxime, on ne voit plus rien de ce noyau ; le troisime consiste dans le repli lin-
trieur du ghetto des fidles ; et le quatrime dans une croisade pour les reprsentations,
les normes et les valeurs dune tradition religieuse dans le but de reconqurir la socit.
17Foi et morale lge de la contingence
Socsoc_v38n01_v2.qxd 11/10/06 15:35 Page 17
-
Ce sont justement ces deux dernires formes qui importent Berger, car il considre le
relativisme, en fin de compte, comme tant psychologiquement insupportable et, par
consquent, il craint en permanence quil ne se transforme en une sorte de fonda-
mentalisme, tant chez les individus quau sein des communauts. Frquemment, le
public peroit justement cette ide-l de Berger comme tant trs plausible. Sa propre
voie, en dpit de son conservatisme politique, est dun point de vue thologique plu-
tt librale, il dit souvent quune voie du milieu entre les extrmes est celle qui lui est
naturelle.
Il y a dautres lments dans les analyses de la religion de Berger que je nai pas sou-
levs ; en particulier, la thse de la privatisation progressive de la religion. La raison est
simple. Cette thse est dsormais considre comme tant rfute, surtout par les tra-
vaux de Jos Casanova dans les Public Religions in the Modern World2, et Berger lui-
mme la rtracte (partiellement : Berger, p. 179 ff), dans la mesure o la privatisation
entranerait aussi le dclin de la religion. Je rappellerais cependant en quels termes se
traduisait le pronostic sur le religieux de Berger en 1968 (dans le New York Times du
25 fvrier de la mme anne) : Au vingt-et-unime sicle, on ne retrouvera vraisem-
blablement de fidles que dans de petites sectes, blotties les unes contre les autres, pour
rsister une culture sculire mondiale. Berger lui-mme qualifie aujourdhui3 ce
pronostic de plus grande erreur (big mistake4) de sa carrire, laquelle, cependant, serait
compense par une ide centrale, savoir la thse dcrite plus haut que le pluralisme
minerait lvidence des contenus et des valeurs de la foi et quil nous incomberait dana-
lyser la situation de la foi cette lumire.
Je considre galement cette grande ide comme tant une big mistake. mon
avis, Berger na pas reconnu le lien entre la thse quil a abandonne et celle laquelle
il tient encore, voire quil a mme renforce. Alors que le champion des pronostics
grossiers sur la scularisation quil fut pendant des dcennies sest transform en avo-
cat dune thorie de la dscularisation5 , il ne voit toujours pas combien sa thorie
de la dynamique du pluralisme est peu soutenable.
Je vais prsent en noncer les raisons. Je vois des objections historiques, sociolo-
giques et philosophiques la construction effectue par Berger.
1. Commenons dabord par les objections historiques. Contrairement Berger,je suis davis que le pluralisme religieux a toujours t inhrent lhistoire europenne
des religions. LEurope na jamais t seulement chrtienne ; le judasme et lislam sont
galement enracins en Europe, les religions prmonothistes nont jamais complte-
ment disparu et ont contribu imprgner les religions subsquentes. Et mme les
religions antiques ont continu dexercer une influence postrieure et subreptice.
18 sociologie et socits vol. xxxviii.1
2. Jos Casanova, Public Religions in the Modern World, Chicago, 1994.3. Peter L. Berger, Protestantism and the Quest for Certainty, The Christian Century, 26 aot - 2 sep-
tembre 1998, p. 782-796.4. En anglais dans le texte (note du traducteur)5. Peter L. Berger (dir.), The Desecularization of the World. Resurgent Religion and World Politics, Grand
Rapids, Mich., 1999.
Socsoc_v38n01_v2.qxd 11/10/06 15:35 Page 18
-
Lexistence dun grand nombre de communauts religieuses dans le mme temps et
le mme espace a t la norme dans lhistoire europenne6 . En somme, limage du
pluralisme moderne de Berger est dtermine par un contraste historique excessivement
prononc, comme sil et t commun jusquau seuil du temps prsent de ntre entour
que de personnes de mme foi et dignorer le doute religieux. Ceci constitue, cependant,
une distorsion complte de lhistoire et ressemble plutt une mise en contraste dicho-
tomique entre homme primitif et culture tardive la Arnold Gehlen7, laquelle, en
effet, a aussi beaucoup influenc la pense de Berger. On trouve, la racine de cette
dichotomie, la prsupposition selon laquelle plus les institutions se passeraient de
rflexion, plus elles seraient fortes. Si, par contre, elles font siennes une marge de
manuvre propice la rflexion et leur propre remise en question, elles perdraient
en puissance. Lintriorisation de normes et de valeurs serait plus superficielle et moins
stable au sein de ces institutions.
Ce sont l, toutefois, les vieilles hypothses dune thorie ultraconservatrice des
institutions qui ne sont gure plus dfendues depuis des dcennies. Helmut Schelsky,
lalter ego intellectuel de Gehlen, avait dj compris, comme le sait srement Berger
(ironiquement dans le contexte dune analyse sociologique du nouveau type institu-
tionnel de lAcadmie protestante), que les marges de manuvre de la rflexion elles-
mmes peuvent avoir un effet de stabilisation et que la rflexion permanente peut tre
institutionnalise8. Mais Berger, comme autrefois Schelsky, demeure en fin de compte
sceptique et ne voit ni lnorme potentiel de stabilisation qui rside justement dans
louverture contrle dune institution la rflexion et lapprentissage, ni comment
de cette manire le passage priodique de lultrastabilit leffondrement de rgime
peut justement tre vit. Il ne voit pas davantage quune intriorisation flexible de
normes et de valeurs ne constitue pas une intriorisation superficielle, mais quelle
peut, plutt, sur le plan personnel, en tant quattention accrue envers lautre en soi et
lextrieur de soi et comme dpassement de la compulsivit, conduire une stabilit
dynamique plutt que statique, comme leffectue le discours sur le plan institutionnel.
Les ides de Berger sur les effets corruptifs du pluralisme sont donc influences par
cette thorie des institutions. Lautre grande faiblesse de son concept du pluralisme est
que celui-ci nest compris quen tant que fait empirique et pas du tout en tant que
valeur! Or, lorsque le pluralisme nest pas compris principalement comme une menace
pour la stabilit institutionnelle et personnelle, il peut tre saisi comme une chance.
Cependant, sil y a des chances lies au pluralisme, alors ce dernier peut lui-mme
devenir une valeur et ds lors un dpassement du pluralisme ou un retour un tat qui
19Foi et morale lge de la contingence
6. Hans G. Kippenberg et Kocku von Stuckrad, Einfhrung in die Religionswissenschaft, Munich, 2003,p. 132; voir aussi : Religionswissenschaftliche berlegungen zum religisen Pluralismus in Deutschland. Eineffnung der Perspektiven, in Hartmut Lehmann (d.), Multireligiositt im vereinten Europa. Gttingen,2003, p. 145-162.
7. Arnold Gehlen, Urmensch und Sptkultur, Bonn, 1956.8. Helmut Schelsky, Ist die Dauerreflexion institutionalisierbar?, Zeitschrift fr evangelische Ethik ?,
1957, p. 153-175.
Socsoc_v38n01_v2.qxd 11/10/06 15:35 Page 19
-
le prcde ne parat aucunement souhaitable. Considrez une valeur comme la tol-
rance ou la libert de culte comme la libert non seulement pour ma confession, mais
aussi pour les confessions des autres, car je veux que leur foi soit authentique et sans
contraintes. Une telle valeur ne reprsente pas une conviction plus faible que les orien-
tations religieuses intolrantes, comme si la tolrance ntait que lacceptation des
autres, faute de meilleures alternatives ralisables, telles que la conversion force, lli-
mination et lexpulsion. Il peut donc sagir dun ethos dfendu avec ardeur, ce qui sex-
primera aussi dans lintolrance envers les ennemis de la tolrance. La philosophie du
pluralisme des valeurs, comme la surtout dveloppe la pense dIsaiah Berlin9, va
encore plus loin quune telle estime de pluralisme. Celle-ci juge non seulement que la
coexistence de systmes de valeurs rivaux peut tre positive et que, dans lintrt de
notre libert de croire, nous devons souhaiter la mme libert pour tous, mais, quen
outre, les valeurs humaines, mme lintrieur dun systme de valeurs, sont irrduc-
tiblement diffrentes et que par consquent, elles entrent invitablement en conflit les
unes avec les autres et sont souvent incompatibles. Selon ce point de vue, chaque rve
dun seul et unique systme de valeurs sans contradictions et de sa ralisation com-
prend le danger de dgnrer en projet totalitaire. Aussi ne peut-on pas simaginer un
progrs qui nentranerait pas la perte dlments mritant dtre conservs. Cest pour-
quoi que lon dit quun pluralisme des valeurs, en ce sens, conduit une conception tra-
gique de lhistoire, et cela est sans doute exact, dans la mesure o aucune pense
progressive linaire nest compatible avec ce pluralisme. Lorsque des systmes de valeurs
sont, ou peuvent en ce sens tre, pluralistes en soi, nos ides sur le rapport quentre-
tiennent entre eux des systmes de valeurs rivaux sen trouvent srieusement modi-
fies. Alors nous ne faisons pas face des choix hermtiquement et rciproquement
scelles, entre lesquelles seule une dcision insondable est possible, et nous pouvons
plutt commencer renvoyer dautres systmes de valeurs des expriences dont ils
sont issus et auxquelles ils continuent de donner un sens. Ces expriences ne nous sont
pas ncessairement trangres ou leur traduction dans notre propre langue est alors,
certes au prix defforts, en principe possible. Lorientation de Berger vers un type
prtendument prmoderne et rpandu dinstitutions et de systmes de valeurs her-
mtiques et dont la validit est indubitable savre donc inadquate pour dfinir his-
toriquement la spcificit du prsent.
2. Cest justement dans le dbat amricain que lon a fait remarquer que Berger
fonde ses jugements historiques sur une situation de monopole territorial religieux,
qui, aux tats-Unis, du moins, na jamais exist et, comme nous lavons vu, est exag-
re dans le cas de lEurope aussi. Tant et si bien que le choc dadaptation supposment
vcu par les communauts religieuses eu gard au pluralisme est, lui aussi, exagr.
Stephen Warner crit : Parmi les centaines dorganisations religieuses qui prosprent
aux tats-Unis trs peu dentre elles on pourrait dire seule lglise piscopale
20 sociologie et socits vol. xxxviii.1
9. Isaiah Berlin, Four Essays on Liberty, Oxford, 1969 ; Hans Joas, Pluralisme des valeurs et universa-lisme moral, Sciences de la socit 52 (2001), p. 77-90.
Socsoc_v38n01_v2.qxd 11/10/06 15:35 Page 20
-
ont eu sajuster une situation pluraliste. La plupart dentre elles y sont nes10 (tra-
duction). Du fait de la longue tradition du pluralisme religieux aux tats-Unis, une
cole de pense entire, un nouveau paradigme pour ltude sociologique de la reli-
gion, sest dsormais dveloppe et renverse carrment lhypothse de Berger. Le plu-
ralisme religieux, selon cette thse, non seulement ne serait pas une cause de
laffaiblissement des convictions religieuses, mais expliquerait carrment la vitalit reli-
gieuse continue des tats-Unis.
Considrons ces arguments sociologiques plus prcisment. Ils ont surtout tdvelopps, comme nous lavons dit, aux tats-Unis et partir de lexemple de ce pays.
Le constat historique leffet que la vitalit religieuse des tats-Unis nest pas, comme
on peut souvent lentendre, un rsultat de lhritage puritain, mais que plutt cette
vitalit a augment tout au long du dix-neuvime sicle et du dbut du vingtime
sicle, est absolument essentiel pour ces arguments. Il ne peut pas plus tre question
dune scularisation accompagnant invitablement la modernisation que dun dve-
loppement simplement diffr par rapport lEurope. On situe, par consquent, la
cause de la vitalit religieuse continue du pays dans la stricte sparation entre ltat et
les glises, constitutionnellement en vigueur depuis la fin du dix-huitime sicle, et
donc dans le pluralisme naturel des communauts religieuses qui concurrencent dans
une sorte de march pour les fidles et leur demande religieuse. Dans ce contexte, les
communauts religieuses seraient conomiquement contraintes de compter sur leurs
clients (et non pas sur ltat) pour se financer. Ceci accrot la probabilit dune acti-
vit de type entrepreneurial de la part des glises et des communauts religieuses, offre
des chances ralistes aux entrepreneurs religieux mergents et force les glises adop-
ter une flexibilit organisationnelle interne et entretenir un lien actif avec les intresss,
comme les nouveaux groupes ethniques immigrs, par exemple. Lorsque sopre pour
dautres raisons une individualisation accrue, les formes amricaines savrent parti-
culirement appropries pour tenir plus fortement compte des besoins qui sy ratta-
chent. Bien que tous ces noncs concernent surtout le domaine des communauts
protestantes, dont les diffrends thologiques se sont amenuises au cours de lhistoire,
et auxquelles, du reste, se sont aussi superposes des diffrends politiques, le domaine
protestant, ne serait-ce que par sa dimension, fait pression sur toutes les autres com-
munauts religieuses pour quelles se dveloppent de faon semblable. Chesterson,
comme on le sait, avait dj constat quen Amrique, mme les catholiques sont pro-
testants.
Ces arguments ont surtout t prsents certes pas exclusivement par des
sociologues qui sorientent sur un modle daction emprunt lconomie11. Le dbat
21Foi et morale lge de la contingence
10. R. Stephen Warner, Work in Progress toward a New Paradigm for the Sociological Study of Religionin the United States, American Journal of Sociology, no 98 (1993), p. 1054.
11. Les reprsentants les plus connus de lapproche du choix rationnel dans le domaine de la sociologiedes religions sont Roger Finke et Rodney Stark. R. Stephen Warner, nomm dans la note de bas de page pr-cdente, qui a jou un rle central dans la dfinition dun nouveau paradigme, ne peut, en revanche, treconsidr comme tant un reprsentant de cette approche. Le recueil suivant propose un aperu utile :Lawrence A. Young (ed.), Rational Choice Theory and Religion. Summary and Assessment, New York, 1997.
Socsoc_v38n01_v2.qxd 11/10/06 15:35 Page 21
-
sur ces travaux est intense et vaste ; ici nest pas le lieu pour aborder les discussions
entremles sur la faon adquate de mesurer le pluralisme et la vitalit religieuse.
Malgr quelques voix contraires, qui affirment que toutes les preuves dun pareil rapport
avances jusqu prsent reposent sur des carences mathmatiques12, il est largement
accept quaux tats-Unis, du moins, il existe un rapport positif entre pluralisme et
vitalit religieuse13.
En revanche, on peut difficilement en dire autant pour lEurope. En Europe, ce
sont justement quelques pays dans lesquels une communaut religieuse unique est
dominante, savoir le catholicisme dans les cas prsents, qui ont maintenu un niveau
lev de religiosit, comme par exemple la Pologne et lIrlande, tandis que la suppres-
sion de rgulations lgales dans dautres pays, comme par exemple dans les pays scan-
dinaves, a renforc la scularisation encore davantage. Mme aux tats-Unis, un
phnomne analogue sest manifest dans le cas des mormons au Utah. Le rapport ne
peut donc pas tre aussi simple que laffirment les conomistes radicaux de la religion.
Lorsquun groupe extrmement concentr gographiquement se conoit nanmoins
comme une minorit dans un environnement plus large et hostile, il peut alors, en
dpit de son monopole territorial, manifestement demeurer religieusement vital. Le
passage dune communaut religieuse une autre nest pas aussi discrtionnaire que ne
le prtend le modle religio-conomique. Les protestants aux tats-Unis, loccasion
dun dmnagement, par exemple, changent effectivement de dnomination fr-
quemment lorsque loffre locale de services (comme les garderies), de sociabilit ou
de spiritualit dune dnomination donne est plus attrayante ; mais ce changement
na lieu qu lintrieur du secteur protestant. Dautres mouvements de conversion sont
clairement des phnomnes collectifs, comme lislamisation des Noirs pauvres ou lat-
trait du mouvement pentectiste chez les immigrants latino-amricains catholiques. Il
rsulte de ces observations et des tudes correspondantes plusieurs avertissements
contre la gnralisation trop rapide du modle le pluralisme conduit la vitalit reli-
gieuse et confie la recommandation aux Europens du disestablishment14 complet des
glises comme mesure de vitalisation religieuse. Dailleurs, le cas de lAllemagne de
lEst, lui aussi, offre loccasion de rectifier lgrement le modle15. La disparition sou-
daine de la rpression religieuse par ltat aurait d, selon ces hypothses, avoir pour
effet que la demande se dirige dsormais de manire accrue vers les communauts reli-
gieuses tablies ou vers de nouveaux mouvements religieux en mergence. Cette attente
se trouve certes confirme dans une srie de socits postcommunistes, mais pas en
Allemagne de lEst. En guise dexplication, on a cit une authentique baisse de la
22 sociologie et socits vol. xxxviii.1
12. Voir par exemple : David Voas, Daniel Olson, Alasdair Crockett, Religious Pluralism andParticipation : Why Previous Research Is Wrong, American Sociological Review, no 67 (2002), p. 212-230.
13. Voir le compte rendu trs critique de Mark Chaves et Philip S. Gorski, Religious Pluralism andReligious Participation, Annual Review of Sociology, no 27 (2001), p. 261-281.
14. En anglais dans le texte (note du traducteur).15. Wolfgang Jagodzinski, Stagnation in den Neuen Bundeslndern? Fehlt das Angebot oder fehlt die
Nachfrage ? , in Detlef Pollack et Gerd Pickel (ds.), Religiser und kirchlicher Wandel in Ostdeutschland1989-1999, Opladen, 2000, p. 48-69.
Socsoc_v38n01_v2.qxd 11/10/06 15:35 Page 22
-
demande religieuse. Ce quon veut dire par l, cest que des athes convaincus, mme
lorsquils jouissent dune libert de culte complte, ne sactivent pas religieusement ;
toutefois, on objecte cette explication quun dialogue sur la religion serait plus facile
avec des athes convaincus quavec des gens compltement indiffrents. Quoi quil en
soit, ceci signifie pour le modle interprtatif que la demande de religion est tout aussi
variable que loffre. Le relchement religieux, tel quon le constate en Allemagne de
lEst, est aussi le rsultat de leffet combin du faible attrait des offrants, lequel remonte
une poque bien plus loigne que le communisme, et dune vritable baisse de la
demande dont la forme est historiquement nouvelle et inattendue. Mme les plus radi-
caux des thoriciens de la scularisation qui avaient certes dj accept la disparition de
la religion, sans toutefois accepter la disparition sans remplacement, avaient investi la
nation ou la dmocratie, linstar dmile Durkheim et de John Dewey respective-
ment, de vastes espoirs de rservoirs de sens.
Avec ces remarques, il ne mimporte pas seulement de renforcer plus empirique-
ment laffirmation du rapport entre pluralisme et vitalit religieuse par des relativisa-
tions et des raffinements historiques ; je veux, en outre, dmontrer que la simple
existence dun march des religions drgularis ne suffit pas expliquer la vitalit de
la religion aux tats-Unis. cet gard, les conomistes de la religion ont autant tort
que tous les conomistes qui attribuent en bloc toutes sortes deffets salutaires aux
marchs drgulariss. Les marchs drgulariss eux-mmes sont soumis, on le sait,
et Randall Collins y a fait rfrence dans notre contexte16 de nouvelles ten-
dances de monopolisation. Ce qui est dcisif, cest que ces tendances nont pas pu pr-
valoir aux tats-Unis. Cela ne tient pas simplement lexistence du pluralisme, mais
linstitutionnalisation de la valeur du pluralisme. Le pluralisme religieux est, aux tats-
Unis, tout comme la religiosit en gnral, une valeur soutenue de diverses manires sur
les plans culturel et institutionnel. Les conomistes de la religion mconnaissent ceci en
raison des prmisses de leur pense.
3. Dans la mme mesure que les points de vue de Berger et des conomistes de la
religion sopposent lgard des liens causaux entre pluralisme religieux et vitalit
religieuse, ces adversaires se conforment lide que la foi soit le rsultat de choix lec-
tifs. Pourtant, de srieux doutes philosophico-psychologiques sy objectent. En tant que
psychologie de la motivation, lhypothse du calcul utilitaire permanent est certaine-
ment inexploitable. Autant il est vrai que la dcision de se joindre telle communaut
en raison de tels avantages ou affinits est informe par des calculs de la sorte, aussi peu
est-il vrai que lexprience rellement constitutive de la foi puisse tre convenablement
caractrise en termes de phnomnologie du choix. Formule dans mon langage
thorique, la foi remonte soit une orientation de valeur et de sens transmise et acquise
dans le processus de la formation de soi, soit ce que je caractrise comme des exp-
riences de la transcendance de soi17. Or justement, une sorte de passivit, de saisisse-
23Foi et morale lge de la contingence
16. Randall Collins, Stark and Bainbridge, Durkheim and Weber. Theoretical Comparisons., in Young(d.), op. cit., p. 161-180.
17. Hans Joas, Die Entstehung der Werte, Francfort sur le Main, 1997.
Socsoc_v38n01_v2.qxd 11/10/06 15:35 Page 23
-
ment, de don de soi est caractristique de cette transcendance. Bien entendu, cette
exprience ncessite une interprtation. Aprs une telle exprience, nous savons seule-
ment que nous avons vcu quelque chose ; notre certitude ne porte pas sur linter-
prtation prcise de cette exprience, comme si celle-ci surgissait simplement de
lexprience ou comme si elle tait toujours compltement printerprte par nos rser-
voirs dinterprtation religieuse et culturelle. Lexprience nous pousse plutt slec-
tionner certaines parties des traditions et les investir dun sens nouveau, tisser de
nouveaux liens partir de traditions ou mme oser notre propre tentative darticu-
lation cratrice, capable de simposer comme une innovation religieuse18. La recherche
sur la conversion est riche en exemples tmoignant tant de lindividualit que de la
typologie de ces processus. Naturellement, dans chaque cas de conversion ou de renou-
veau religieux, il y a un moment de dcision, un point tournant, partir duquel lan-
cien systme de rfrence nest plus accept, mais est rinterprt en fonction des
concepts du nouveau systme de rfrence ; aussi ne peut-on pas nier quarriv ce
point tournant, une volont, un saut, un acte soient ncessaires pour suivre sa propre
disposition religieuse19. Mais cette volont quivaut un don de soi et cest justement
pourquoi elle doit tre clairement et conceptuellement diffrencie dun choix lectif
entre des prfrences. Les valeurs ne sont pas des prfrences long terme ou des pr-
frences dun ordre plus lev, mais des talons rflexifs servant lvaluation de nos
prfrences, des conceptions charges motionnellement de ce qui est souhaitable et
non pas des souhaits en soi. ce titre, elles sappuient en nous sur des sentiments dvi-
dence et de certitude ; ce sont ces sentiments qui nous guident dans la recherche dune
articulation convenable et qui perdurent dans leur intensit, mme lorsque nous pre-
nons conscience de la contingence de notre contexte biographique et de nos exp-
riences. Dans la mme mesure que la simple connaissance dune valeur ou dune
personne ne produit aucun lien, la connaissance rationnelle dune diversit de possi-
bilits nbranle pas un lien dj existant.
Ainsi, jaffirme que la thse de Berger selon laquelle le pluralisme a un effet rduc-
teur dintensit provient de sa fausse proximit avec la conception conomique de la
prfrence. Du coup, la situation devient ironique, dans la mesure o Berger a justement
tir la mauvaise conclusion des attaques empiriques sur le concept de la scularisa-
tion. Il dfend lancienne hypothse dun effet dbilitant du pluralisme sur la religio-
sit, mais se rapproche des ides conomiques sur le choix de prfrences religieuses,
alors quil aurait d, au contraire, se soumettre au constat en vertu duquel le plura-
lisme peut faire crotre la vitalit religieuse, mais aussi montrer que ce constat empiri-
quement correct des conomistes de la religion ne peut justement pas sexprimer avec
cohrence dans leur propre cadre conceptuel.
Berger en vient mme se contredire, puisquil sait dcrire avec beaucoup de sen-
sibilit les expriences transcendantes comme tant les bases de la foi. Or, immdiate-
24 sociologie et socits vol. xxxviii.1
18. Hans Joas, Braucht der Mensch Religion?, Fribourg, 2004.19. William James, The Varieties of Religious Experience, New York, [1902] 1982.
Socsoc_v38n01_v2.qxd 11/10/06 15:35 Page 24
-
ment la suite de pareilles descriptions, il affirme une fois encore quaujourdhui les
convictions religieuses seraient gnralement plus superficielles quautrefois et que les
gens qui ont des ides religieuses inbranlables [auraient] tendance [ recourir] de
tels moyens de persuasion svres comme lpe, la chambre de torture et le bcher
(Berger, p. 183, traduction). La conclusion concernant la morale que tire Berger de ses
analyses me parat galement peu plausible. Il affirme que quoique le pluralisme [ait]
plong et la religion et la morale dans une crise de relativisation, il est plus ais pour la
plupart des gens dacqurir une certaine certitude morale quune certitude religieuse
(Berger, p. 204, traduction). Toutefois, il me semble quil y a l une confusion entre
certitude subjective et plausibilit intersubjective. Nous pouvons aussi nous entendre,
en ce qui a trait la morale, avec des gens dautres persuasions religieuses, mais cela ne
signifie pas que nous soyons plus srs en matire de morale quen matire religieuse.
Le croyant va respecter, en vertu de sa foi, des commandements moraux dont le sens
particulier doit lui paratre injustifiable lextrieur de sa foi. Jinterromps ici largu-
mentation philosophique sur le thme de la certitude contingente, de la certitude
dans la conscience des sources contingentes de ma certitude ; elle naura servi ici qu
dmontrer linsuffisance de la thse du pluralisme de Berger laune de son concept de
la foi ; ici nest pas le lieu dexpliquer ce que nous entendons par convictions religieuses.
Toutefois, toutes les composantes ncessaires une alternative Berger devraient
dsormais tre runies. Le pluralisme naffaiblit pas la foi, telle est notre conclusion, mais
peut plutt mme la renforcer sous rserve de certaines conditions. Cest pourquoi je
plaide en faveur dune rorientation, qui se dtournerait de lattention centrale porte
sur les problmes du pluralisme et de lintgration sociale, vers ceux dune contingence
accrue20. Nous caractrisons de contingent ce qui nest ni ncessaire, ni impossible
ce qui donc existe, mais dont lexistence nest pas invitable.
Contingent est antonymique ncessaire et cela signifie que son sens prcis est
dpendant de celui du concept de la ncessit. Nous caractrisons de contingents les
incidents que nous rencontrons dans notre vie, quils soient terribles ou plaisants, mais
aussi lexprience de notre propre libert de dcision et daction, ainsi que de ses cons-
quences. Nous parlons de contingence accrue parce que la marge de manuvre alloue
nos actions a grandi et que la part des incidents qui ne sont pas indpendants de
laction et sont le produit de laction dautrui a augment. Si cette affirmation est exacte,
alors la question dcisive dans notre contexte est de savoir ce que signifie la contin-
gence accrue pour la foi et la morale aujourdhui. Nous savons ce quen disent les thses
pessimistes de Berger. Une des raisons de leur plausibilit apparente, surtout dans les
cercles protestants, rside srement dans la relation trangement divise de la tradition
protestante par rapport au rle constitutif des institutions et de la vie sociale en gn-
ral dans le dveloppement de lindividualit. Le vacillement de Berger entre des insti-
tutions surpuissantes et une individualit libre tmoigne justement de cette
25Foi et morale lge de la contingence
20. Voir Hans Joas, Wertevermittlung in einer fragmentierten Gesellschaft, in Nelson Killius et al.(d.), Die Zukunft der Bildung, Francfort sur le Main, 2002, p. 58-77.
Socsoc_v38n01_v2.qxd 11/10/06 15:35 Page 25
-
ambivalence. Cette ambivalence peut devenir productive lorsquelle exhorte la
recherche dinstitutions et de formes sociales qui facilitent et encouragent lindividua-
lisation. Elle peut savrer strile lorsquelle conduit un scepticisme rigide envers le
cur ardent des institutions, la pratique du rituel et le langage de la sacralit. Robert
Bellah, un autre important sociologue protestant des religions aux tats-Unis, qui
cet gard fait figure dantipode de Berger, parle dans ce contexte de failles dans le
code protestant par exemple dans la comprhension de leucharistie et en a tir
la consquence personnelle de se joindre la variante amricaine de langlicanisme21.
Considre depuis une telle synthse individualiste-communautaire, mme lhistoire de
la Rforme et de la Contre-Rforme apparat sous un nouveau jour. Nous discernons
alors mieux les possibilits constructives offertes par une contingence accrue. Comme
on peut le dmontrer sur le plan des relations personnelles, de nouvelles formes adap-
tes une contingence accrue se laissent bel et bien dvelopper. De linstitution au
compagnonnage, telle tait dj dans les annes 1920 la formule de la sociologie am-
ricaine de la famille, formule qui, videmment, sopposait la notion voulant que
seules une perte dorientation et une inscurit dans le comportement puissent prendre
la place dinstitutions rigides. Cependant, les efforts de dfinition et de coordination en
matire de relations conjugales, tout comme la ncessit fonctionnelle dune perception
sensible de lautre et des spcificits de chaque situation mais cest justement l quil
y a un gain faire ou, du moins, la chance de trouver une forme de stabilit.
La situation est analogue pour la foi et la morale. Jai diffrenci dans dautres tra-
vaux trois directions par lesquelles lattachement aux valeurs doit sadapter pour se
conformer aux conditions dune contingence croissante. Il sagit de 1) la procdurali-
sation, de 2) la gnralisation des valeurs et de 3) lempathie. Nous avons dj rencon-
tr la procduralisation dans le prsent expos, dans la mesure o elle signifie la
reconnaissance vritable de profondes diffrences dans la perception du monde et des
positions dintrt et le confinement au rglement pacifique des conflits selon des rgles
respectes de tous. Mes exemples dthique de la tolrance et de garantie juridique de
la libert de culte expriment justement ces articulations de valeurs adaptes la contin-
gence. Par leurs biais, la diffrence en soi nest plus source de conflit ; les rgles de
conduites elles-mmes sen trouvent investies dune signification morale trs leve.
La tendance de la procduralisation est centrale pour le droit et pour la morale, mais
pas pour la foi au sens strict. Car la procduralisation ne concerne pas lattachement aux
valeurs en tant que tel, dans la mesure o les attachements aux valeurs ne sont pas
prts accepter des procdures communes que dans un rapport rciproque.
La deuxime forme nomme ci-dessus, la gnralisation des valeurs, est toute
autre22. Dans ce cas, diverses traditions de valeurs particulires dveloppent en inter-
26 sociologie et socits vol. xxxviii.1
21. Robert Bellah, Flaws in the Protestant Code : Some Religious Sources of Americas Troubles, inEthical Perspectives, no 7 (2000), p. 288-299
22. Jemprunte ce concept louvrage de Talcott Parsons. Voir son essai Comparative Studies andEvolutionary Change, in Social Systems and the Evolution of Action Theory, New York, 1977, p. 279-320 ;surtout p. 307 et suivantes.
Socsoc_v38n01_v2.qxd 11/10/06 15:35 Page 26
-
action les unes avec les autres une comprhension gnrale et souvent plus abstraite de
leurs notions communes. Ainsi, toutes les religions du monde peuvent dvelopper par
le dialogue interreligieux leur propre potentiel de justification des droits de lhomme
et de lide de la dignit humaine universelle. Ceci nest videmment possible qu
condition quaucune tradition religieuse nexige des autres quelles renoncent elles-
mmes et quil ne soit attendu daucune tradition religieuse quelle sefface en faveur de
justifications rationalistes. Plutt, dans le cas de la gnralisation des valeurs, le soutien
affectif dune tradition religieuse et sa force particulire dattachement sont conservs.
Troisimement, une contingence accrue fait appel au dveloppement de capacits
empathiques. Ces conditions font en sorte que les individus sont constamment confron-
ts des situations dans lesquelles ils doivent eux-mmes dcouvrir ce quils veulent,
doivent et peuvent faire. Et ceci ne leur est possible quen intriorisant les ralits
uniques de leurs partenaires daction et des situations daction respectifs. Un moment
de libert accrue fait son entre dans lattachement aux gens, aux valeurs et aux com-
munauts de foi ; plus que par le pass, lattachement demeure fortement li un
consentement libre toujours renouvel.
Des trois formes dorientation conformes la contingence que jai nommes, jes-
time que la gnralisation des valeurs est la plus importante. La raison en est que la
procduralisation et lempathie demeurent vides si elles ne procdent pas de la gn-
ralisation des valeurs. Certes, la capacit dempathie gnralise connat diffrents
degrs, mais nous savons aussi que la mesure dans laquelle les gens sont vritablement
disposs entretenir des sentiments moraux envers autrui, cest--dire laisser leurs
capacits se matrialiser, est aussi dpendante dune motivation nourrie de valeurs
substantielles, comme, par exemple, lamour du prochain. Et lapprentissage de pro-
cdures lgales ou participatives est constamment menac de retomber dans le simple
calcul dintrt si aucune valeur ne motive prouver ces procdures comme tant
prcieuses. En ce sens, jestime que la transmission de valeurs doit aussi dominer une
ducation lempathie et un apprentissage des procdures.
Quels desiderata produisent ces rflexions pour les responsables de la transmis-
sion des valeurs et de la foi? Il est purement primordial de sortir de lauto-intimidation
fonde sur la thorie de la scularisation. Cette intimidation sest transforme, en
Europe, en prophtie formelle qui sexauce delle-mme; qui y croit va lui-mme se
fourvoyer dans une sorte denttement antimoderne, comme sil sagrippait sa foi
pour rsister aux tendances de la modernisation, tout en tant plus ou moins conscient
de dfendre une cause perdue. Ainsi, les possibilits de processus dindividualisation
dans le domaine de la foi sont systmatiquement values avec trop de pessimisme.
Un premier niveau de rflexion touche donc la perception de lhistoire et de la socit
qui sest introduite dans la reprsentation de soi des glises. Le second niveau apparat,
si on rappelle mon ide fondamentale que les valeurs sont issues dexpriences et que
la foi reprsente une interprtation dexpriences dautotranscendance. Si cela est vrai,
le systme dducation ne peut alors transmettre des valeurs que sil permet et encou-
rage des expriences susceptibles dengendrer un attachement aux valeurs ou encore,
27Foi et morale lge de la contingence
Socsoc_v38n01_v2.qxd 11/10/06 15:35 Page 27
-
sil contribue maeutiquement larticulation et linterprtation de telles expriences.
Troisimement, chacun de ces processus dispose ncessairement dune dimension per-
sonnelle. Sans tmoignage, lenseignement des valeurs communique lindiffrence ; la
reprsentation des valeurs par des personnes, toutefois, rclame de leur part une dis-
position lempathie, la procduralisation et la gnralisation des valeurs.
Quatrimement, il faut prendre en considration le fait que les processus dducation
ne sont intentionnellement contrlables que dans une faible mesure, mais que, dautre
part, ils se produisent continuellement. Cela signifie que le caractre lui-mme des ta-
blissements ducatifs, leur tat architectural, leurs structures internes, leur compr-
hension de soi aussi en tant que forme de vie ou labsence dune pareille comprhension
de soi se rpercutent souvent davantage sur les processus de formation que les inten-
tions des responsables en matire dducation. Dans les tablissements denseignement
ecclsiastiques en Allemagne, cette conscience est heureusement toujours reste plus
veille que dans les tablissements tatiques. Cinquimement, les valeurs ne peuvent
finalement pas tre transmises si leur articulation au temps actuel ne russit pas. Une
petite part de doute sur la question de savoir si nous-mmes incarnons vraiment de
manire crdible les valeurs que nous proclamons doit ainsi accompagner chaque ten-
tative de transmission de valeurs et chaque rflexion sur notre propre responsabilit en
matire dducation.
rsum
Cet article aborde de manire critique un aspect important de la sociologie des religions de PeterBerger, notamment son hypothse que le pluralisme moderne affaiblirait la religion. Cettehypothse est aborde sur les plans historique, sociologique et psychologique. Je soutiens queBerger exagre lhomognit religieuse du pass, nglige les effets revitalisants du pluralismereligieux et dforme lmergence de lengagement religieux en lui appliquant la notion de choix.Cet article se conclut par des rflexions sur les possibilits qui soffrent une foi religieuseadapte aux conditions du pluralisme moderne et dune contingence croissante.
abstract
This paper is a critical discussion of an important point in Peter Bergers sociology of religion,namely his assumption that modern pluralism weakens religion. This thesis is discussed on ahistorical, sociological and psychological level. I argue that Berger exaggerates the religioushomogeneity of the past, neglects the revitalizing effects religious pluralism can have, and distortsthe emergence of religious commitment by applying the notion of choice to it. The paper endswith some reflections on the possibilities for a religious faith that is adapted to the conditions ofmodern pluralism and increasing contingency.
resumen
Este artculo aborda de manera crtica un aspecto importante de la sociologa de las religionesde Peter Berger, en particular, su hiptesis que el pluralismo moderno debilitara la religin. Esta
28 sociologie et socits vol. xxxviii.1
Socsoc_v38n01_v2.qxd 11/10/06 15:35 Page 28
-
hiptesis se aborda a nivel histrico, sociolgico y psicolgico. Mantengo que Peter exagera lahomogeneidad religiosa del pasado, descuida los efectos revitalizantes del pluralismo religiosoy deforma la aparicin del compromiso religioso aplicndole el concepto de eleccin. Este artculose concluye con reflexiones sobre las posibilidades que se ofrecen a una fe religiosa adaptada alas condiciones del pluralismo moderno y de una contingencia creciente.
bibliographie
Bellah R. (2000), Flaws in the Protestant Code : Some Religious Sources of Americas Troubles, Ethical
Perspectives, no 7, p. 288-299.
Berlin, I. (1969), Four Essays on Liberty, Oxford.
Berger, P. L. (d.) (1999), The Desecularization of the World. Resurgent Religion and World Politics, Grand
Rapids, Mich.
Berger, P. L. (1998), Protestantism and the Quest for Certainty , The Christian Century, 26 aot
2 septembre, p. 782-796.
Berger, P. L. (1992), A Far Glory. The Quest for Faith in an Age of Credulity, Free Press New York.
Casanova, J. (1994), Public Religions in the Modern World, University of Chicago Press.
Chaves, M. et P.S. Gorski (2001), Religious Pluralism and Religious Participation , Annual Review of
Sociology, no 27, p. 261-281.
Collins, R. (1997), Stark and Bainbridge, Durkheim and Weber. Theoretical Comparisons., in L.A.Young
(d.), Rational Choice Theory and Religion. Summary and Assessment. Routledge, New York, p. 161-
180.
Gehlen, A. (1956), Urmensch und Sptkultur, Athemgm Bonn.
Jagodzinski, W. (2000), Stagnation in den Neuen Bundeslndern ? Fehlt das Angebot oder fehlt die
Nachfrage?, in D. Pollack et G. Pickel (ds.), Religiser und kirchlicher Wandel in Ostdeutschland 1989-
1999, Opladen, p. 48-69.
James, W. ([1902] 1982), The Varieties of Religious Experience, Penguin, New York.
Joas, H. (2004), Braucht der Mensch Religion?, Herder, Fribourg.
Joas, H. (2003), The Genesis of Values, Chicago, University of Chicago Press.
Joas, H. (2002), Wertevermittlung in einer fragmentierten Gesellschaft , in N. Killius et al. (ds.), Die
Zukunft der Bildung. Suhrkamp, Francfort sur le Main, p. 58-77.
Joas, H. (2001), Pluralisme des valeurs et universalisme moral, Sciences de la socit, 52, p. 77-90.
Kippenberg, H. G. et K. von Stuckrad (2003a), Einfhrung in die Religionswissenschaft, C. H. Beck,
Munich.
Kippenberg, H. G. et K von Stuckrad. (2003b), Religionswissenschaftliche berlegungen zum religisen
Pluralismus in Deutschland. Eine ffnung der Perspektiven, in H. Lehmann (d.), Multireligiositt
im vereinten Europa, Wallstein, Gttingen, p. 145-162.
Parsons, T. (1977), Comparative Studies and Evolutionary Change, in Social Systems and the Evolution
of Action Theory, Free Press, New York 1977, p. 279-320.
Schelsky, H. (1957), Ist die Dauerreflexion institutionalisierbar ? , Zeitschrift fr evangelische Ethik ?
p.153-175.
Voas, D., D. Olson, A. Crockett (2002), Religious Pluralism and Participation : Why Previous Research
Is Wrong, American Sociological Review, no 67, p. 212-230.
Warner, R.S. (1993), Work in Progress toward a New Paradigm for the Sociological Study of Religion in
the United States, American Journal of Sociology, no 98, p. 1044-1093.
Young, L. A. (d.) (1997), Rational Choice Theory and Religion. Summary and Assessment, Routledge,
New York.
29Foi et morale lge de la contingence
Socsoc_v38n01_v2.qxd 11/10/06 15:35 Page 29